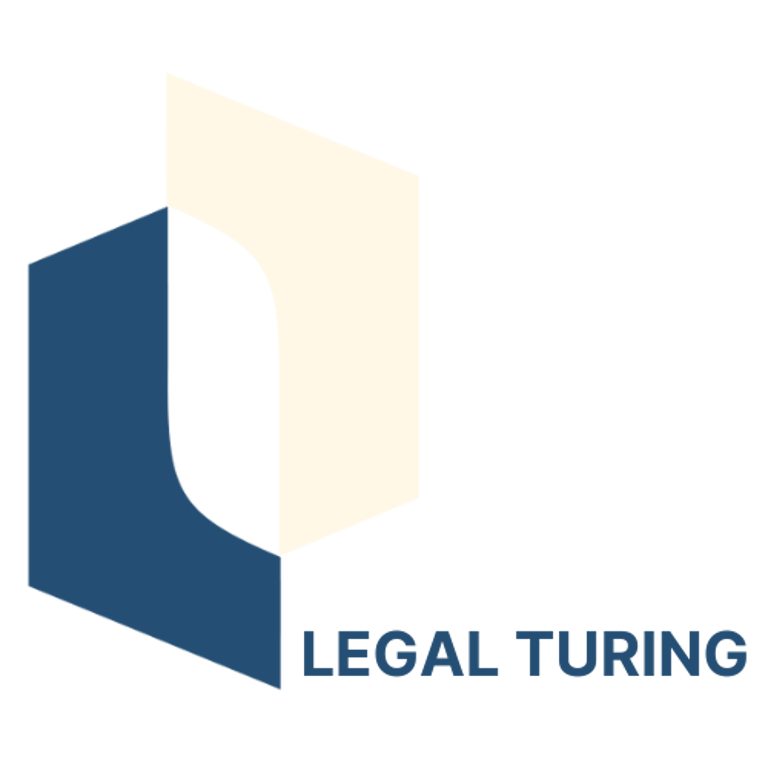Y a-t-il encore un conducteur humain responsable au volant ?
Aujourd’hui, le droit positif français encadre les nouvelles technologies dans les véhicules terrestres à moteur (VTM). Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. Le droit a dû évoluer pour s’adapter aux VTM équipés d’une assistance à la conduite afin de déterminer la responsabilité en cas d’accident de la circulation.
VOITURE PARTIELLEMENT OU 100% AUTONOME
C.Becouze
7/13/20244 min read


L’accident mortel de la circulation du 17 juin 1999
Le tribunal correctionnel de Saverne a jugé un concessionnaire et une conductrice d’un VTM avec assistance à la conduite pour homicides involontaires et blessures involontaires. La conductrice risquait 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d’amende, tandis que Volvo, en tant que personne morale, risquait une amende allant jusqu’à 225 000 euros.
Le tribunal a dû établir si la défaillance technique du système de freinage du VTM de Volvo pouvait exonérer la conductrice, en partie ou totalement. Il a également examiné si Volvo et le concessionnaire pouvaient être tenus responsables de l’accident.
La conductrice a affirmé qu’elle était responsable car elle conduisait le véhicule, mais qu’elle n’était pas coupable. Elle avait pris toutes les mesures possibles pour éviter le drame. Le passager a déclaré : « Dans la descente, elle m’a dit : j’ai plus de freins. »
Le tribunal a cherché à comprendre pourquoi les freins n’ont pas fonctionné malgré la révision récente du système. Le directeur général de Volvo Automobiles France affirma : « Après huit ans d’expertises, nous sommes convaincus que l’accident n’a pas été causé par une défaillance technique. » Volvo soutenait que leur système de freinage fonctionnait correctement et qu’ils ne pouvaient pas être tenus responsables.
Volvo et le garagiste de Souffelweyersheim ont dû prouver leur innocence face aux accusations de responsabilité. Une bataille d’experts a eu lieu pour déterminer les véritables responsabilités. La justice a conclu à une défaillance du système de freinage.
La place juridique du dernier maillon dans la chaîne de la causalité
Le tribunal a établi que la défaillance du système de freinage représentait une cause indirecte mais certaine de l’accident mortel du 17 juin 1999. Il a reconnu la conductrice comme directement responsable, car elle était le « dernier maillon dans la chaîne de la causalité ». Elle a reçu une peine de six mois de prison avec sursis, une suspension de permis d’une année, ainsi qu’une amende de 300 euros pour homicides et blessures involontaires.
Le tribunal correctionnel de Saverne a également condamné Volvo à une amende de 200 000 euros pour co-responsabilité dans l’accident mortel.
La présence d’une aide à la conduite ne peut pas exonérer le conducteur de la responsabilité en cas d’accident. Toutefois, un VTM avec une assistance défaillante peut rendre le constructeur co-responsable.
Un nouveau facteur de risque à prendre en compte dans les accidents de la circulation
Le tribunal correctionnel de Saverne a condamné Volvo à une amende de 200 000 euros suite à l’accident du 17 juin 1999, qui a coûté la vie à deux piétons mineurs à Wasselonne. Cette décision repose sur la découverte d’une défaillance technique dans le système de freinage du VTM de Volvo.
La co-responsabilité du constructeur n’exonère pas le conducteur
Dans l’affaire du 17 juin 1999, la justice a jugé Volvo comme co-responsable et la conductrice comme directement responsable du drame. Le tribunal a examiné une cause indirecte et une cause directe selon l’ancien article 121-3 du Code pénal :
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »
Comprendre le point de départ de l’accident permet de saisir la chaîne d’événements ayant conduit au drame et d’établir les responsabilités.
La cause indirecte et directe de l’accident de circulation
L’article ancien et nouveau 121-3 du Code civil définit la causalité comme suit :
Causalité indirecte : Un tiers a contribué à la réalisation du dommage en créant ou en contribuant à créer une situation à l’origine du dommage.
Causalité directe : Un tiers a contribué à une situation permettant la réalisation du dommage, ou a omis d’intervenir comme il le devait. Cela inclut un comportement imprudent, négligent ou un manquement à une obligation de prudence.
Le lien de causalité est le lien de cause à effet entre la faute d’un tiers et le préjudice subi. La loi du 10 juillet 2000 a clarifié que la causalité est le critère pour apprécier la responsabilité pénale.
La défaillance du système de freinage a contribué au dommage de manière indirecte. La conductrice aurait pu éviter l’accident en prenant une autre décision. Son choix représente la cause directe du dommage, car elle aurait pu éviter l’accident en contrôlant son véhicule malgré l’absence de freinage.
La loi Badinter comme socle important en matière d’accidents de la circulation
Au moment de l’accident du 17 juin 1999, l’article L123-1 du Code de la route n’était pas encore en vigueur. Il a été introduit le 16 avril 2021, par l’ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 – art. 1. De plus, l’article R 412-6 du Code de la route, concernant le contrôle du véhicule, n’existait pas encore. Il a été introduit le 2 août 2008, par le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 15. Le droit positif sur les VTM avec assistance à la conduite n’était pas encore établi.
La décision du tribunal repose sur la loi Badinter du 5 juillet 1985, pierre angulaire du droit français en matière d’accidents de circulation, à condition de remplir quatre critères :
Un VTM
Un accident de la route
L’implication du VTM dans l’accident
Un dommage résultant de l’accident
La loi Badinter a permis au tribunal d’affirmer que, bien que le système de freinage de Volvo ait été défaillant, il a contribué au dommage de manière indirecte. La conductrice, étant le « dernier maillon dans la chaîne de la causalité », reste directement responsable de l’accident mortel de 1999.
Le conducteur doit toujours maîtriser son véhicule pour éviter d’endosser une responsabilité directe, tout en ne dégageant pas le constructeur Volvo de sa responsabilité dans l’accident mortel du 17 juin 1999.
Copyright © 2024 Legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter