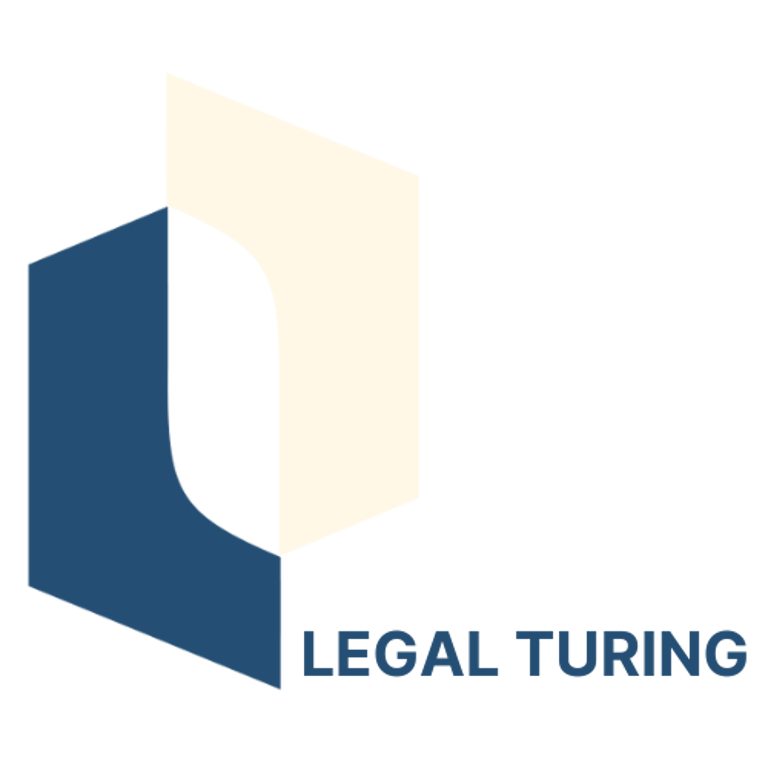Réglementation des voitures (VTM) autonomes : ce qui est indispensable
Pourquoi s’interroger sur un cadre juridique spécifique pour les VTM autonomes ? Pour comprendre les enjeux juridiques, il est crucial d’examiner l’origine juridique de la responsabilité liée aux machines ainsi que ses conséquences pour les responsables et les victimes des dommages. En effet, tout comme la révolution industrielle de 1908 a contraint le droit à s’adapter, la révolution numérique actuelle pousse le droit positif à évoluer pour éviter l’obsolescence.
VOITURE PARTIELLEMENT OU 100% AUTONOME
C.Becouze
6/16/20243 min read


Évolution historique de la responsabilité en droit
Avant l’ère industrielle, les machines n’existaient pas ; en conséquence, les accidents étaient exclusivement dus à la faute humaine. Cependant, avec l’avènement de l’ère industrielle et l’apparition des machines, les accidents ont commencé à être causés par ces dernières. Josserand a d’ailleurs noté que « en devenant industriel et mécanique, l’accident devient aussi anonyme ».
Par conséquent, le développement du machinisme a rendu la responsabilité du fait personnel inadaptée pour ce type de sinistralité. Ainsi, le droit a dû introduire le concept de responsabilité du fait des choses, affirmé dès 1896.
Responsabilité du fait des choses et évolution législative
Depuis l’arrêt Teffaine, les tribunaux ont établi que le propriétaire d’une chose causant un dommage doit réparer le préjudice. En conséquence, l’ancien article 1384 du Code civil, devenu l’article 1242, s’applique aux choses relevant de la responsabilité du fait des choses.
En outre, la jurisprudence de l’arrêt Dame Cadé exige que la chose joue un rôle actif, c’est-à-dire qu’elle soit l’instrument ou la cause du dommage. De ce fait, la victime doit prouver deux éléments :
L’intervention matérielle de la chose.
Le rôle de la chose dans la cause du dommage.
Il est donc essentiel de comprendre la notion de propriétaire responsable du dommage en droit. Dès qu’un propriétaire est identifié, il est présumé être le gardien de la chose, conformément à la jurisprudence de l’arrêt Jand’heur.
Limites et évolutions de la responsabilité du gardien
Malgré cela, la jurisprudence de l’arrêt Franck apporte des précisions importantes. Ainsi, le propriétaire peut voir sa responsabilité écartée s’il prouve l’un des deux cas suivants :
Un transfert involontaire par la perte de la chose.
Un transfert volontaire.
En droit civil, le gardien de la chose assume la responsabilité de tout dommage causé par celle-ci. En effet, selon l’arrêt Franck, le gardien est la personne qui utilise, dirige et contrôle la chose.
Encadrement juridique des accidents de la circulation
Le principe de responsabilité pour faute a évolué depuis le Code civil de 1804. La doctrine française souligne que « la responsabilité était vue comme un rapport inter-individuel entre l’auteur du dommage et sa victime ». D’autre part, la responsabilité subjective se réfère à la faute personnelle, tandis que la responsabilité objective concerne la responsabilité sans faute. Ainsi, en 1804, le droit favorisait l’individualisme/libéralisme.
À la fin du 19e siècle, la doctrine française a introduit la collectivisation de la réparation. Cette collectivisation a non seulement élargi la notion de faute mais aussi celle de réparation, entraînant ainsi un déclin de la responsabilité individuelle. Par conséquent, nous observons un passage d’une responsabilité subjective à une responsabilité collective et objective.
En outre, les accidents de la circulation sont maintenant encadrés par la loi, notamment par la loi Badinter de 1985. Cette loi a mis en place un système d’indemnisation autonome et efficace pour permettre aux victimes d’accidents de la route d’obtenir une réparation intégrale.
En effet, dans un arrêt du 4 mai 1987, n°85-17.051, la plus haute juridiction civile a confirmé que la loi Badinter exclut les autres régimes de responsabilité. Ainsi, une victime d’accident de la route ne peut pas se fonder sur la responsabilité personnelle ou contractuelle.
De plus, les arrêts de la 2e chambre du 5 juillet 2018, n°17-19.738, montrent que l’assurance automobile applique les dispositions d’ordre public de la loi Badinter de 1985.
Les défis posés par les nouvelles technologies
En complément de la jurisprudence et de la loi du 5 juillet 1985, le droit interne français inclut également le Code de la route et le Code des assurances, qui encadrent les accidents de circulation. Il est donc clair que la législation régit déjà les accidents de la circulation.
Cependant, il est crucial de réguler les nouvelles technologies avec une législation appropriée. Or, le droit actuel n’a pas été conçu pour les nouvelles technologies et les véhicules autonomes.
En conséquence, la législation actuelle repose sur l’idée que l’automobiliste conduit un VTM, qu’il soit ou non responsable d’un accident. Cela soulève plusieurs problématiques juridiques :
Existe-t-il un droit international commun pour les VTM partiellement et totalement autonomes ?
Le droit européen prévoit-il des cadres juridiques spécifiques pour ces VTM ?
Faut-il modifier la loi Badinter de 1985 ?
Le droit français encadre-t-il efficacement les évolutions technologiques des VTM avec assistance à la conduite ?
Les VTM partiellement autonomes modifient-ils la responsabilité pénale de l’automobiliste en cas d’accident ?
Peut-on appliquer la notion de victime au conducteur impliqué dans un sinistre routier causé par un VTM partiellement autonome défaillant ?
Le droit positif s’applique-t-il aux VTM entièrement autonomes ?
Copyright © 2024 Legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter