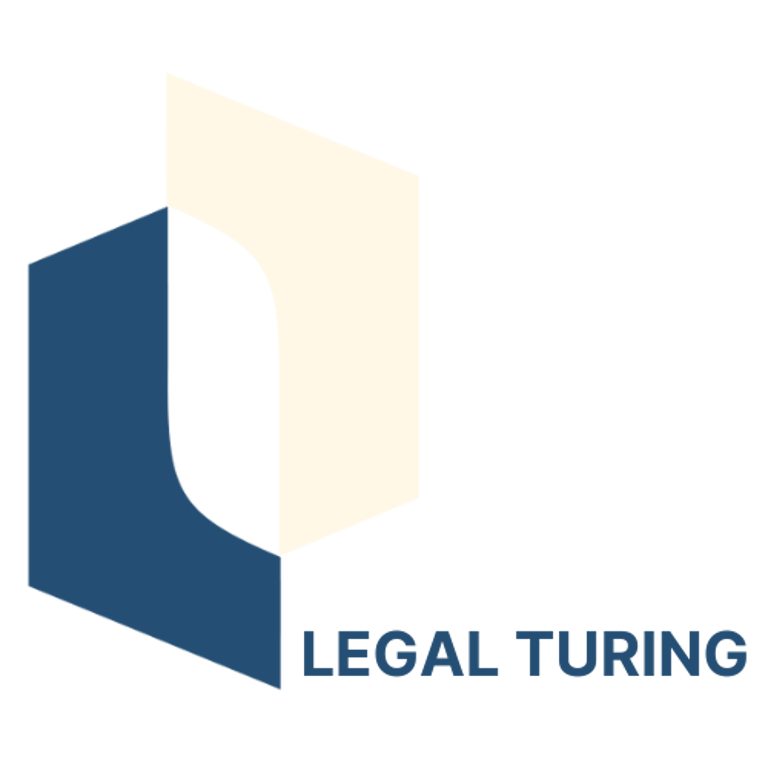L'écriture par IA : réflexions artistiques et philosophiques
Dans une société où les innovations technologiques évoluent à très grande vitesse, l'écriture par intelligence artificielle (IA) soulève de nombreuses questions d'ordre éthique, juridique. Notre société moderne doit faire face à un nouveau type de ghostwriters.
L'IA DANS NOTRE SOCIÉTÉ
C.Becouze
5/3/20253 min read


Les ghostwriters, l’intelligence artificielle et la redéfinition de l’auteur
Les ghostwriters sont des auteurs humains anonymes dont l'objectif est de créer des œuvres littéraires pour le compte d'autrui. Cette profession se trouve confrontée à un nouveau concurrent : l’intelligence artificielle (IA). En effet, l'humain oriente, donne des prompts, et c’est l’IA qui fabrique l'œuvre. Mais cela est-il moins artistique ? N'est-ce tout simplement pas une nouvelle forme d'art¹ ?
L'identité du créateur d'une œuvre : une question récurrente à travers les siècles
Il faut savoir qu'à l'époque de la Renaissance, des assistants peignaient parfois une partie d’une œuvre signée par le maître. Ainsi, ce n’est pas forcément celui qui réalise ladite œuvre qui compte, mais celui qui pense l’œuvre. D'ailleurs, les exemples sont nombreux :
Marcel Duchamp et son Urinoir (1917) : il utilise un urinoir industriel classique, le signe, puis le présente comme une œuvre d’art². L’artiste n’a pas fabriqué l’objet ; il l’a détourné de son usage premier. Il s’agit donc plus d’un acte intellectuel que manuel.
Sol LeWitt ne réalisait pas lui-même ses œuvres. En effet, ce sont d’autres personnes qui exécutaient ses instructions pour les réaliser³.
Ainsi, l’idée prime sur l’exécution. Ce qui peut être reconnu comme une œuvre d’art, c’est la pensée originale ou le concept imaginé par l’artiste. De ce fait, peu importe parfois qui est à l’origine du coup de pinceau ou du tracé réalisé à la main.
Un autre exemple est celui des songwriters fantômes dans l’industrie musicale. Certaines chansons célèbres sont écrites par des auteurs ou compositeurs parfois anonymes pour des interprètes eux-mêmes célèbres. L’auteur importe moins que celui qui interprète l'œuvre ; ce qui compte, c’est l’impact sur celles et ceux qui écoutent la chanson.
De la même manière, une IA générative (IAG) peut produire du texte, une œuvre, de la musique, mais ne signe jamais son travail. L’IAG agit dans l’ombre, sans aucune reconnaissance directe, car c’est toujours l’utilisateur humain qui est mis en lumière et qui, au final, décide par qui l’œuvre est signée⁴.
Implication éthique de l’écriture par l’IAG
Au-delà des enjeux financiers et juridiques, l’avènement de l’écriture grâce à l’IAG met en lumière des défis éthiques importants. L’ajout d’une IA dans cette équation rend la situation complexe à de nombreux égards.
D’un point de vue éthique, l’utilisation d’une IAG pour créer des œuvres littéraires soulève des craintes quant à la transparence et à l’honnêteté de l’auteur. Les lecteurs, ainsi que le public en général, méritent de savoir si une œuvre est le fruit d’un être humain ou d’algorithmes. Il s’agit là d’une question cruciale, qui touche à l’authenticité de l’œuvre.
Roland Barthes écrivait déjà en 1967 :
« La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur »⁵.
À la lecture de cette formule, on peut constater que Barthes anticipait déjà ce que le monde numérique et l’IA nous obligent à repenser : le créateur, en ce début du XXIe siècle, est totalement décentré. L’œuvre peut vivre sans lui, car la seule chose qui compte réellement, c’est l’expérience du lecteur, du spectateur, de celui qui écoute ou utilise.
Vers une redéfinition de l’art… et de l’auteur
Les ghostwriters, les songwriters fantômes et les IAG jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous concevons l’écriture et l’art aujourd’hui. La fusion de ces univers peut enrichir notre culture, mais elle nécessite également une réflexion critique sur la propriété intellectuelle et l’authenticité, afin de préserver aussi bien l’intégrité de l’art que celle des artistes.
Notes de bas de page
Duchamp, M. (1917). Fountain. L’œuvre fut signée « R. Mutt » et rejetée à l’époque, avant d’être reconnue comme l’un des actes fondateurs de l’art conceptuel.
LeWitt, S. (1967). Paragraphs on Conceptual Art, dans Artforum.
En droit français, seul un humain peut juridiquement être reconnu comme auteur (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Barthes, R. (1967). La mort de l’auteur, dans Manteia, n°5.
Copyright © 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter