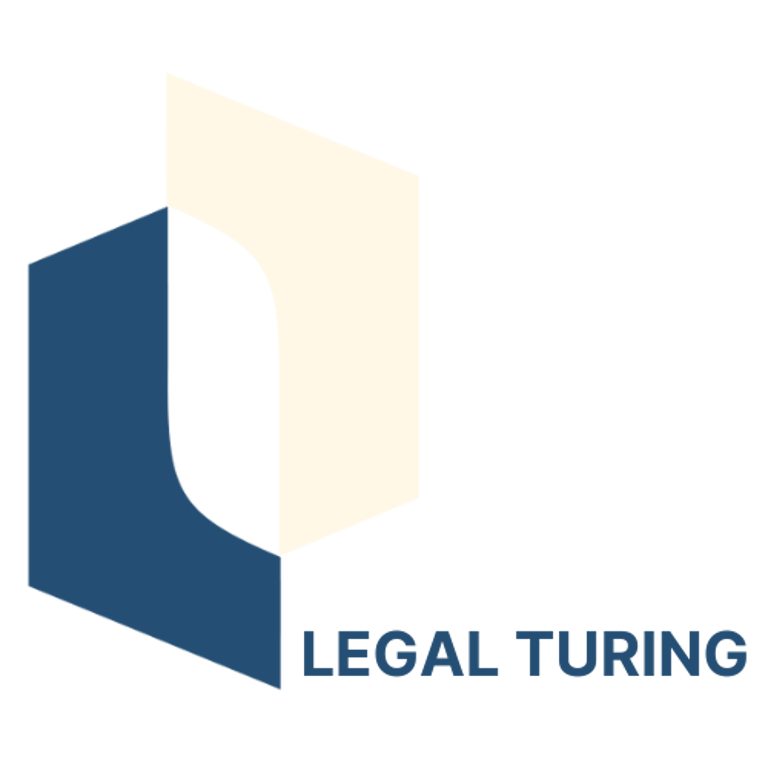Le statut juridique du robot : personne, bien, ou entité hybride ?
Robot et droit : bien matériel, personne morale ou entité inédite ? Un regard sur l’évolution du cadre juridique.
DROIT ET ROBOTIQUE
C.Becouze
8/20/20257 min read


À l’image de l’évolution qu’a connue la responsabilité civile depuis l’ère préindustrielle, l’émergence des robots intelligents dit aussi sophistiqués dotés d’une certaine autonomie de décision vient bouleverser les cadres juridiques existants. En effet, comme à l’époque de la révolution industrielle, où le développement des machines a rendu obsolète le seul recours à la faute humaine, le développement de la robotique interroge la pertinence des régimes de responsabilité fondés uniquement sur la faute ou sur la garde d’une chose. Par ailleurs, Josserand constatait déjà que « l’accident devient anonyme » avec le machinisme. De la même manière, l’intervention des robots rend parfois difficile l’identification d’un auteur fautif, surtout lorsque l’algorithme fonctionne de manière autonome, sans instruction directe.
Statut juridique des robots sophistiqués
En ce milieu d'année 2025, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies robotiques rend la question du statut juridique des robots plus pressante que jamais. En effet, l'augmentation de leur utilisation dans divers secteurs, tels que la santé, l'automobile, ainsi que la logistique, soulève de nombreuses interrogations sur la façon dont ces entités doivent être classées sur le plan légal. Par ailleurs, cette interrogation, au cœur des débats actuels, s’inscrit dans la continuité de la résolution du Parlement européen du 16 février 2017, qui proposait d’envisager une personnalité juridique spécifique pour les robots les plus autonomes. En outre, à l’image de l’évolution du droit ayant conduit à reconnaître les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du Code civil), obligeant la société à repenser leur statut entre objet et sujet. De même, les robots intelligents soulèvent aujourd’hui des questions fondamentales :
Doivent-ils être considérés comme de simples outils ?
Méritent-ils un statut reflétant leur capacité à interagir de façon autonome avec leur environnement ?
Ainsi, dans le cadre de cette analyse, il est important de prendre en compte les implications éthiques et sociales qui découlent de la reconnaissance des robots en tant qu'entités potentielles avec des droits. C'est dans ce contexte, que les législateurs et chercheurs s’efforcent ainsi de concevoir un cadre juridique dans lequel les droits humains peuvent coexister avec ceux d'entités non humaines, tout en préservant la dignité et la sécurité des individus. Les enjeux ne sont pas seulement techniques ou juridiques : ils sont profondément moraux. La manière dont nous classifierons les robots influencera directement les responsabilités que nous leur attribuons, la place que nous leur accordons dans notre quotidien, et plus largement, notre rapport à l’intelligence artificielle dans la société.
Assimiler le robot à un bien
La classification des robots en tant que biens matériels soulève des questions légales complexes, car elle s'inscrit dans le cadre des lois traditionnelles régissant la propriété. En général, les biens sont définis comme des objets matériels qui peuvent être possédés, échangés ou utilisés. Cependant, en raison de leur nature technologique et autonome, les robots introduisent des nuances notables dans ce modèle classique de propriété.
Les propriétaires de robots sont responsables de leur utilisation et, par conséquent, de tout dommage que ces dispositifs pourraient causer. En effet, l'article 1242 du Code civil (ancien art. 1384) dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Cela signifie que, dans le cadre des robots, une personne peut se voir assigner une responsabilité légale en cas d'accident impliquant un robot. Ainsi, dans la logique de l’article 1242 du Code civil, on pourrait envisager de considérer le robot comme une chose dont le propriétaire ou le gardien est responsable. De ce fait, cela s’inscrirait dans la continuité de la jurisprudence Jand’heur, selon laquelle il suffit que la chose soit l'instrument du dommage et que son gardien soit identifié.
Néanmoins, ce principe de la responsabilité du fait des choses pose des défis importants, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de culpabilité ou de négligence impliqué dans le fonctionnement autonome du robot. En effet, cette approche montre ses limites lorsque le robot agit sans intervention humaine directe, par exemple lorsqu’il apprend ou prend des décisions de manière autonome. La responsabilité du gardien pourrait alors apparaître injuste ou inadaptée, comme le montre la jurisprudence Franck sur la perte de la garde.
En outre, de même que la responsabilité du fait personnel est devenue insuffisante à l’ère industrielle, la responsabilité du fait des choses devient à son tour limitée face à l’autonomie des systèmes intelligents comme les robots sophistiqués. En effet, elle ne permet pas de prendre en compte les spécificités de l’action robotique, ni la complexité de l’interaction entre l’humain, la machine et l’environnement numérique. De ce fait, l’intervention matérielle et le rôle actif exigés par l’arrêt Dame Cadé ne suffisent plus à déterminer clairement le lien de causalité ou le régime applicable, ce qui ouvre la voie à de nouvelles pistes.
En outre, la question de l'assurance des robots devient cruciale. Comme pour tout bien, la couverture d'assurance est essentielle pour protéger le propriétaire contre d'éventuelles réclamations résultant de l'utilisation de leur robot. Les compagnies d'assurance doivent créer des produits spécifiques pour faire face aux risques associés à l'utilisation de robots, mais cela nécessite une compréhension approfondie des implications juridiques. En effet, la difficulté tient à la multiplicité des acteurs impliqués et à la nature non-humaine de l’entité qui cause potentiellement le dommage, ce qui rend la construction de modèles d’assurance beaucoup plus complexe. Néanmoins, tout comme le bonus-malus automobile incite à la prudence, un système similaire pourrait émerger pour les technologies autonomes lorsqu'un dommage est causé par un robot sophistiqué.
En outre, il convient aussi de considérer les avantages et les inconvénients de la classification des robots comme biens. D'un côté, cela facilite la réglementation et la gestion des robots dans la société, tout en offrant un cadre pour la responsabilité. D'un autre côté, cela pourrait également limiter la potentialité des robots comme entités autonomes, en conférant à leur propriétaire une forme de contrôle absolu qui pourrait freiner l'innovation. Cette dynamique entre propriété et autonomie continue d'alimenter le débat juridique concernant le statut des robots dans la société moderne.
Personnalité juridique et robotique
L'idée de reconnaître les robots comme des personnes juridiques suscite un débat de plus en plus intense dans le domaine juridique et éthique. En envisageant une telle possibilité, il est essentiel d'examiner non seulement les implications techniques, mais aussi les conséquences sociales, économiques et judiciaires.
En effet, cette transformation pourrait entrainer des modifications conséquentes des systèmes juridiques existants. Actuellement, la personnalité juridique est réservée aux individus et à certaines entités, comme les entreprises. Cette évolution vers une reconnaissance des robots sophistiqués en tant que potentiellement entités juridiques hybrides pourrait ouvrir la voie à des droits spécifiques pour des robots, comme le droit à la protection des données ou la capacité de posséder des biens. Toutefois, il serait primordial de définir clairement les limites et conditions de cette personnalité robotique, afin d'éviter une confusion potentiellement nuisible dans le cadre juridique.
La distinction entre la personnalité juridique humaine et celle des robots pourrait également engendrer de nombreuses interrogations juridiques, comme par exemple :
Comment la société percevrait-elle la souffrance ou les droits des robots ?
Est-ce qu'un robot sophistiqué mis sur le marché disposera d'un patrimoine propre qui lui sera associé ?
Si le patrimoine du robot sophistiqué ne suffit pas que faudra-t-il faire ?
Faudra-t-il envisager de verser une rémunération au robot sophistiqué afin qu'il puisse enrichir son patrimoine ?
Surtout quels types de robots sophistiqués pourront prétendre à une reconnaissance juridique ?
Ne risque-t-on pas d'installer un nouveau type d'esclavagisme technologique voir de discrimination robotique ?
Ces questionnements invitent à réfléchir sur la valeur que nous accordons à l’intelligence non humaine et sur l’impact que cela pourrait avoir sur notre développement technologique.
Vers un modèle hybride pour les robots sophistiqués
La question du statut juridique des robots demeure complexe et multifacette, oscillant entre l'assignation d'un statut de bien et celle d'une entité dotée de droits. L'émergence de modèles mixtes pourrait offrir une solution intermédiaire, reconnaissant aux robots non seulement leur nature matérielle, mais également certains attributs spécifiques qui pourraient leur conférer des droits limités. Cette approche hybride permettrait de mieux répondre aux défis croissants posés par l'intelligence artificielle et l'automatisation tout en garantissant une régulation adéquate.
Dans un tel cadre, les robots pourraient être considérés comme des biens, tout en jouissant d'une reconnaissance légale de certaines de leurs capacités autonomes. Par exemple, un robot conçu pour effectuer des tâches dans un contexte médical pourrait être doté de droits restreints liés à la protection des données personnelles des patients qu'il traite. Les implications législatives de cette proposition sont vastes ; il serait nécessaire de définir des lignes directrices qui préciseront les droits et les obligations de ces entités hybrides. Le défi pour les législateurs réside dans l’équilibre à trouver entre encourager l’innovation et protéger les individus.
Pour illustrer ces notions, plusieurs solutions juridiques ont été avancées, par exemple :
Comme la loi Badinter de 1985 a permis de dépasser les limites des anciens régimes en créant un système objectif d’indemnisation pour les accidents de la circulation, certains juristes envisagent de reconnaître au robot un statut juridique spécifique, voire une personnalité juridique électronique. Cela permettrait de créer un régime autonome de responsabilité, adapté à leurs capacités décisionnelles.
Le cadre juridique européen sur l’intelligence artificielle vise à établir des standards pour la responsabilité en cas de dommage causé par des systèmes autonomes, tout en tenant compte des spécificités de leur rôle dans la société.
La France et ses régimes du fait des choses et celui des produits défectueux qui permettent de garantir la sécurité lors du déploiement de robots dans les environnements publics.
Par conséquent, il est crucial de réfléchir aux conséquences éthiques et sociétales de la reconnaissance d'un statut hybride pour les robots. En adoptant une approche réfléchie, les législateurs peuvent faciliter l'intégration des nouvelles technologies tout en préservant les valeurs essentielles de la sécurité et du bien-être public.
Copyright © 2024 Legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter