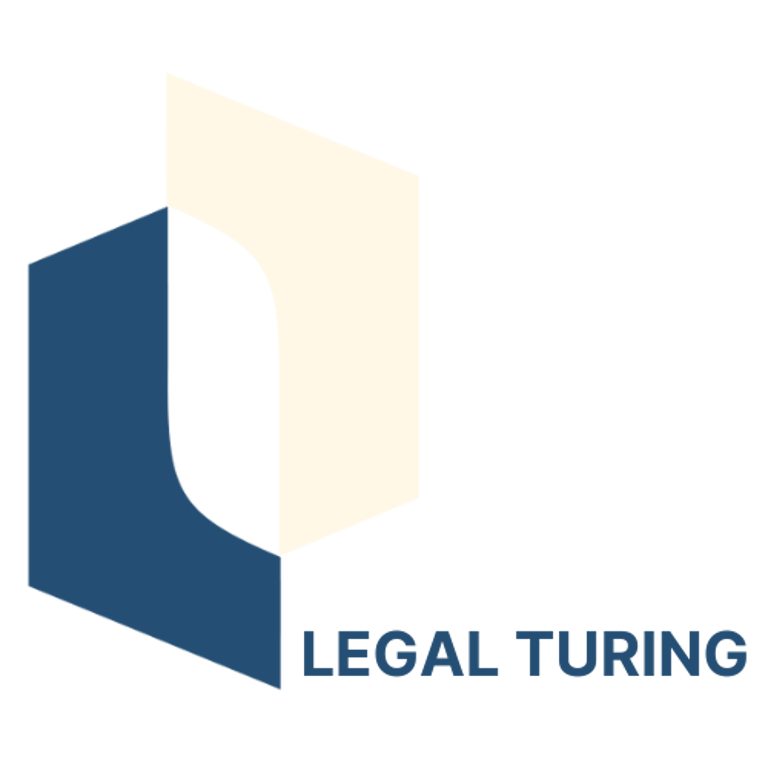L'affaire New York Times contre OpenAI : un examen juridique
Dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) transforme les médias, l'affaire New York Times contre OpenAI suscite des débats juridiques importants. Cet article explore les enjeux juridiques de cette affaire qui soulève des questions pertinentes sur le droit d'auteur.
LE DROIT À L'ÈRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
C.Becouze
6/18/20255 min read


Genèse du litige
Le 27 décembre 2023, le célèbre journal le New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et son principal investisseur, Microsoft, pour violation des droits d'auteur. En effet, le journal affirme que ses articles ont été utilisés sans autorisation pour développer des produits d'IA générative de la société OpenAI, causant ainsi un préjudice qui serait estimé à plusieurs milliards de dollars pour ledit journal. En outre, le New York Times affirme que ses contenus ont joué un rôle clé dans l'entraînement des modèles d'IA, ce qui prouve, selon lui, la valeur reconnue de son travail journalistique. Comme le dit le célèbre adage : tout travail mérite salaire.
Décision judiciaire récente
C’est dans ce contexte qu’en avril 2025, le juge fédéral Sidney Stein a autorisé la poursuite de l’essentiel de la plainte du New York Times, rejetant ainsi les tentatives d’OpenAI et de Microsoft visant à faire annuler l’affaire. En effet, le juge a estimé que les preuves fournies notamment des exemples où ChatGPT reproduisait presque mot pour mot des articles du célèbre journal étaient donc suffisantes pour justifier la poursuite de l’examen judiciaire. Néanmoins, certaines accusations, telles que celle de concurrence déloyale, ont été purement et simplement écartées.
La réponse d'OpenAI
OpenAI conteste vigoureusement les accusations, allant jusqu'à affirmer que l'utilisation de données publiques pour entraîner ses modèles relève tout simplement du "fair use" (usage équitable) selon le droit américain.
L’utilisation d’une œuvre par un tiers de manière équitable
Aux États-Unis, il faut savoir que les tribunaux s’appuient sur quatre éléments clés afin d’évaluer si l’utilisation d’une œuvre peut être considérée comme équitable (fair use) :
La finalité et le caractère de l’usage, notamment s’il s’agit d’un usage commercial ou d’un usage éducatif et non lucratif ;
La nature de l’œuvre, en prenant en compte son originalité ou son caractère factuel ;
La quantité et la substance de la partie utilisée, en fonction de sa proportion par rapport à l’ensemble de l’œuvre et de sa valeur informative ;
L’effet de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur économique de l’œuvre originale.
1) Comparaison entre le fair use américain et les exceptions légales françaises : deux visions du droit d’auteur
Ainsi, le système juridique américain, avec la notion de fair use, se distingue par sa flexibilité. En effet, ce mécanisme, fondé sur des critères d’appréciation judiciaire (finalité de l’usage, nature de l’œuvre, quantité utilisée, effet sur le marché), permet aux juges d’évaluer au cas par cas si une utilisation non autorisée d’une œuvre peut être jugée équitable. Cette approche offre donc une marge d’interprétation bien plus large, autorisant éventuellement l’émergence de nouvelles exceptions en dehors d’un cadre strictement législatif.
À l’inverse, le droit positif français, et plus largement le droit d’auteur de tradition civiliste, repose sur une logique de protection rigide du créateur. En effet, les exceptions au droit d’auteur y sont limitativement énumérées dans le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 122-5 et suivants). De ce fait, seules les hypothèses expressément prévues par la loi (telles que la courte citation, la parodie ou l’usage pédagogique dans certaines conditions) peuvent justifier l’absence d’autorisation de l’auteur. Par ailleurs, il convient de noter que le juge français n’est pas habilité à créer de nouvelles exceptions, même en présence d’un usage qui pourrait être jugé légitime ou de bonne foi.
En résumé, là où le fair use consacre une approche pragmatique et évolutive centrée sur l’usage de l’œuvre, le droit français privilégie une conception patrimoniale et morale de la création, centrée sur la préservation des prérogatives exclusives de l’auteur.
2) Le fair use peut-il s’appliquer dans le système juridique français ?
La question de l’applicabilité du fair use en dehors des pays de common law, et en particulier en France, soulève d’importants enjeux de droit international privé.
En effet, en l’absence de clause contractuelle spécifique, la solution doit être recherchée à la lumière de la Convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques. Son article 5 pose le principe selon lequel la législation applicable est celle « du pays pour lequel la protection est réclamée ». Cela signifie que la loi du pays où l’atteinte au droit d’auteur a eu lieu souvent assimilée à la loi du lieu du fait dommageable (lex loci delicti) doit donc s’appliquer.
Par ailleurs, la jurisprudence française a confirmé cette approche. Un auteur étranger peut ainsi bénéficier en France des mêmes droits qu’un auteur national. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les exceptions prévues dans son droit national, notamment le fair use, lui seraient automatiquement opposables en France. Le juge français reste en effet lié par les seules exceptions prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, en cas de litige, une utilisation couverte par le fair use aux États-Unis pourrait être considérée comme une contrefaçon en France. Il ne faut pas oublier non plus que la qualité d’auteur et donc la titularité initiale des droits est déterminée par la loi du pays d’origine de l’œuvre, conformément à l’article 5(2) de la Convention de Berne.
Vers une convergence des systèmes juridiques en vue d’une meilleure harmonisation juridique mondiale
Ainsi, bien que les approches française et américaine semblent opposées. En effet, l’approche française protégeant l’auteur comme titulaire de droits exclusifs, tandis que l’approche américaine favorise la libre circulation des idées il convient de noter que, malgré cette opposition de principe, des dynamiques récentes témoignent d’une évolution vers une harmonisation progressive entre les deux systèmes juridiques.
En effet, la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (2019/790) introduit par exemple des exceptions davantage orientées vers l’usage, comme la fouille de textes et de données (text and data mining), en réponse aux nouveaux enjeux liés à l’IA.
De ce fait, les deux systèmes tendent à se rapprocher, non pas dans leurs fondements, mais dans leur finalité commune : permettre l’exploitation économique des œuvres tout en prenant en compte, dans une certaine mesure, les intérêts publics liés à l’accès à l’information et à la culture.
Néanmoins, dans ce contexte de tension entre protection des droits d’auteur et ouverture à de nouveaux usages permis par l’IA, l’affaire opposant le New York Times à OpenAI illustre de manière concrète les défis posés par l’articulation entre innovation technologique et respect des cadres juridiques existants.
Enjeux et perspectives
Ainsi, cette affaire soulève donc des questions fondamentales sur la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA. De ce fait :
Si le New York Times obtient gain de cause, cela pourrait obliger les entreprises d'IA à revoir complètement leurs méthodes d'entraînement et donc à indemniser les créateurs de contenu.
À l'inverse, une victoire d'OpenAI renforcerait la position selon laquelle l'utilisation de données publiques est légitime pour le développement de l'IA.
Par conséquent, ce procès pourrait établir des précédents juridiques déterminants pour l'avenir de l'IA et des droits d'auteur dans les systèmes juridiques de tous les Etats.
Copyright © 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter