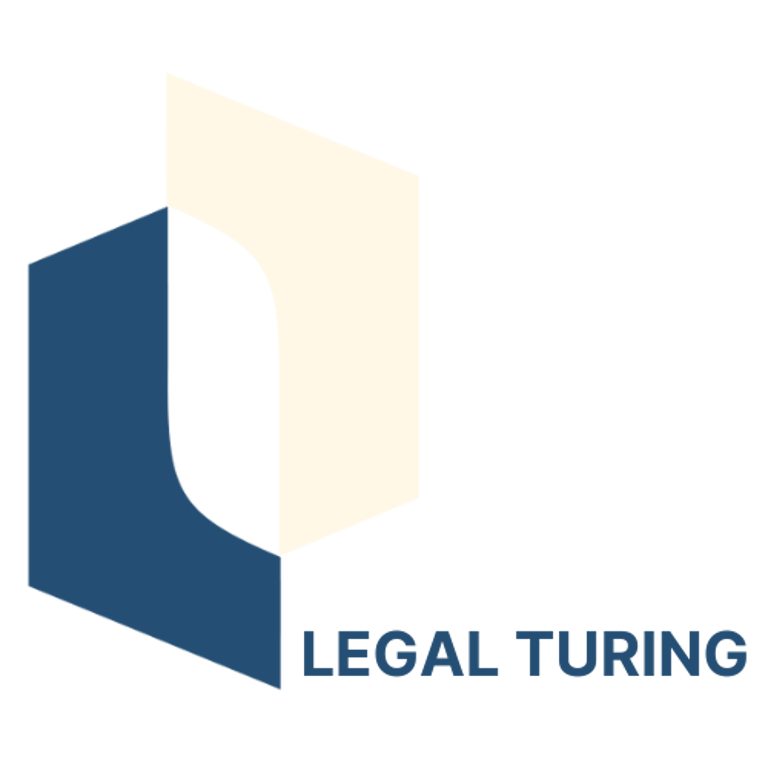L’affaire He Jiankui : éthique et génétique
La question de la protection des droits humains face aux avancées de la génétique est un véritable casse-tête. Un exemple frappant est celui de He Jiankui, un scientifique chinois dont les expériences ont soulevé une tempête de questions éthiques. Il a modifié les gènes d’embryons humains pour les rendre résistants au SIDA, en utilisant CRISPR-Cas9, cette technologie révolutionnaire souvent décrite comme des « ciseaux génétiques ». Mais en agissant sans la validation éthique appropriée, He Jiankui a mis en lumière des dilemmes cruciaux.
LE DROIT RÉGULATEUR DE LA SCIENCE
C.Becouze
7/5/20243 min read


Les avancées scientifiques et les dilemmes éthiques
Ainsi, cette technologie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR – en français : courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) a le potentiel de transformer notre approche de la génétique. Elle permet des modifications très précises de l’ADN. De ce fait, cette technologie ouvre la voie à des avancées comme le diagnostic préimplantatoire. Elle aide à choisir des embryons sans maladies génétiques, ce qui est prometteur pour améliorer la qualité de vie. Néanmoins, cette puissance scientifique pose des questions éthiques et juridiques.
Le cadre juridique et l’amélioration de l’espèce
Les règles encadrant les interventions génétiques sont strictes. D’ailleurs, la Convention d’Oviedo, notamment son article 13, précise que toute modification du génome humain doit être justifiée par des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, sans viser à altérer le génome des générations futures. En France, l’article 16-4 du Code civil va plus loin en interdisant l’eugénisme et le clonage reproductif, avec des sanctions sévères en cas de violation. Cette législation reflète la volonté de protéger l’intégrité de notre espèce.
Les arguments juridiques contre l’amélioration de l’espèce
Les objections à l’amélioration de l’espèce humaine sont nombreuses. L’histoire des crimes contre l’espèce, tels que l’eugénisme et le clonage, démontre la gravité des préoccupations. De plus, la protection des générations futures, bien qu’encore conceptuelle et non entièrement codifiée, est essentielle. Des figures comme le doyen Carbonnier affirment que « la condition de mortalité est une question d’ordre public ». De ce fait, certaines recherches scientifiques, telles que la cryogénisation, pourraient être en contradiction avec les principes fondamentaux de la société, car :
– Implications légales et sociales : en effet, si une personne cryogénisée était « réanimée » à l’avenir, cela pourrait entraîner des complications juridiques liées à son identité, ses biens, etc.
– Éthique et intégrité humaine : il faudrait repenser la définition que nous avons de la mort et le respect de l’intégrité du corps, etc.
– Risque d’inégalités : l’accès à la cryogénisation pourrait devenir un service réservé à une minorité de la population, ce qui soulèverait des questions d’équité au sein de la société.
Ainsi, certaines avancées scientifiques pourraient entrer en conflit avec les structures sociales et légales établies.
Le rôle du droit comme censeur
Le droit sert de barrière contre les dérives potentielles des recherches. En effet, il permet de réguler les progrès scientifiques pour préserver l’éthique. De ce fait, même si les scientifiques ont des capacités impressionnantes, le système juridique intervient pour modérer les excès. En effet, le droit permet au législateur de se positionner pour déterminer jusqu’où l’intervention humaine est moralement acceptable.
De ce fait, le droit est un moyen de temporiser la recherche scientifique, car Il impose un cadre juridique, des débats éthiques. Par ailleurs, le droit n'a pas pour objectif d’entraver le progrès scientifique, mais de s’assurer que la recherche scientifique soit conforme aux principes fondateurs de notre société moderne, tels que : la dignité humaine, l’égalité, le respect du secret médical.
Ainsi, le droit sert de contre-pouvoir scientifique. En effet, il permet de rappeler que tout ce qui est techniquement possible n’est pas pour autant socialement souhaitable.
Équilibre éthique et scientifique : l’affaire He Jiankui
Par conséquent, trouver un équilibre entre les avancées scientifiques et les considérations éthiques est crucial. L’affaire He Jiankui nous rappelle les risques des initiatives non régulées et l’importance d’un cadre juridique solide. Le droit, en tant que régulateur, joue un rôle indispensable et donc fondamental pour prévenir les abus et garantir que les avancées scientifiques bénéficient à la société.
Copyright © 2024 Legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter