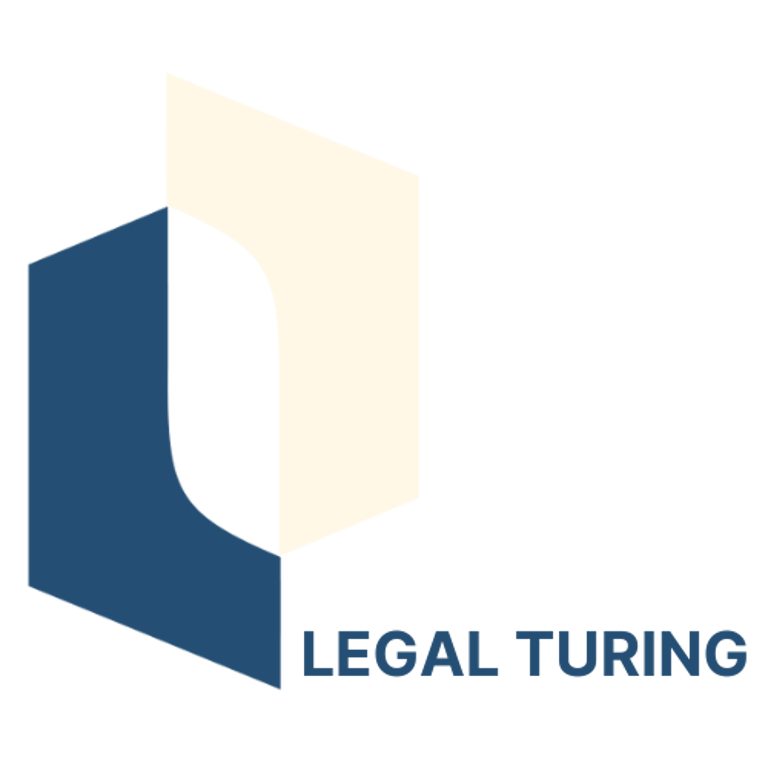La science-fiction et son impact sur le droit
La science-fiction anticipe les défis juridiques liés aux technologies émergentes, comme l'IA et la surveillance, influençant ainsi le droit face aux mutations sociétales.
DROIT ET SCIENCE-FICTION
C.Becouze
9/27/20247 min read
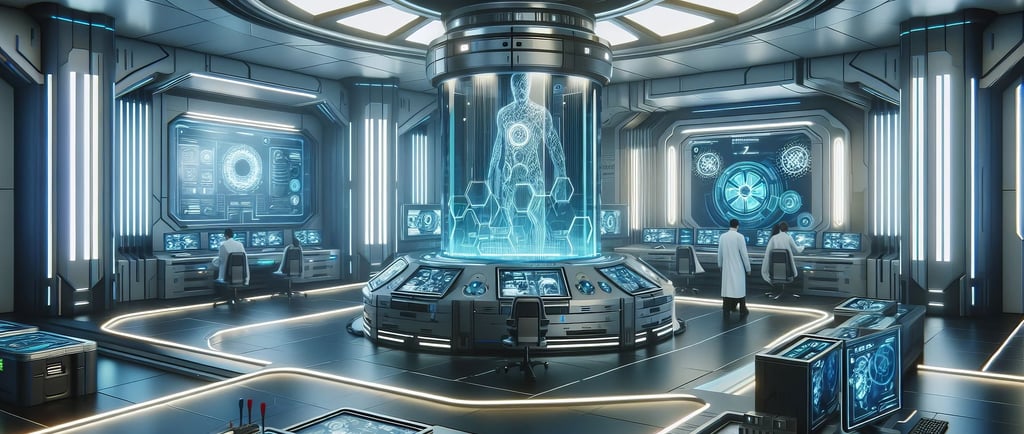

La science-fiction est un genre littéraire ou cinématographique qui fascine l’imagination des individus à travers le globe. En effet, la science-fiction permet non seulement de découvrir des futurs hypothétiques tant sur un plan technologique que social, mais aussi d’inciter à des réflexions critiques sur l’éthique et les droits en vigueur dans nos sociétés contemporaines. Ainsi, par le biais de récits imaginaires, la science-fiction offre un cadre idéal pour explorer des scénarios alternatifs découlant des innovations technologiques ou des modifications sociopolitiques.
Depuis ses origines, la science-fiction a servi de miroir, reflétant les préoccupations et les dilemmes de chaque époque. Les œuvres marquantes, telles que celles de Philip K. Dick ou d’Isaac Asimov, soulèvent des interrogations sur la nature des lois et des droits individuels dans des sociétés futuristes. Par exemple :
I. Asimov a introduit des concepts éthiques complexes et novateurs à travers ses célèbres lois de la robotique, qui incitent à se questionner sur notre rapport aux machines et le cadre légal qui doit les encadrer. Ainsi, cela permet de soulever des questions fascinantes sur le droit positif et le droit prospectif, telles que la responsabilité juridique des intelligences artificielles et les droits des êtres non humains.
D’ailleurs, cette réflexion n’est plus cantonnée à la science-fiction. En effet, le Parlement européen, dans sa résolution datant du 16 février 2017, a directement abordé ces questions en envisageant la création d’un cadre juridique pour les robots. Ainsi, cette résolution s’inspire des principes qu’on pourrait qualifier d’asimoviens pour examiner la responsabilité juridique des robots sophistiqués. En effet, elle met en avant les défis pour le droit positif, mais aussi pour le droit prospectif, qui devra anticiper les innovations futures et garantir un cadre juridique dans l’usage des nouvelles technologies.
En outre, la science-fiction permet d’explorer des sujets tels que la surveillance de masse, le contrôle gouvernemental, la justice prédictive et les dérives autoritaires que ces innovations technologiques pourraient engendrer. Par exemple :
Le film Minority Report réalisé par Steven Spielberg et produit par Gerald R. Molen, Bonnie Curtis, et Walter F. Parkes. Il s’inspire d’une nouvelle du même nom écrite par Philip K. Dick. Cette histoire plonge dans un futur dystopique où des individus qu’on nomme des précogs sont dotés de capacités pour prédire les crimes avant que ces derniers ne soient commis, permettant ainsi à la police d’agir en amont. Ainsi, cette œuvre de science-fiction soulève des interrogations complexes sur le libre arbitre, la responsabilité morale, ainsi que sur la présomption d’innocence. Cette œuvre met en lumière les risques d’un système judiciaire automatisé qui pourrait sacrifier les libertés des individus au nom de la sécurité.
Ce sujet est d’une pertinence telle que l’Union européenne dispose depuis 1er août 2024 du règlement européen sur l’IA (RIA), qui vise à établir un cadre légal pour garantir que les systèmes et outils d’IA soient conçus et aussi utilisés de manière à minimiser les risques pour les individus et la société. En effet, le RIA dit aussi AI act dispose de 4 niveaux de risques qui placerait d’office la technologie utilisée dans Minority Report dans le niveau 1, qui est celui du risque inacceptable et donc tout simplement interdit.
Ainsi, grâce aux récits fantastiques, les écrivain(e)s invitent les lecteurs à réfléchir sur la direction que pourrait prendre le droit dans nos sociétés technologiques.
Cet article juridique va explorer le dialogue entre la science-fiction et le droit. Ensuite, nous examinerions les défis sociétaux contemporains des nouvelles technologies. Enfin, nous analyserons l’osmose entre science-fiction et droit.
Anticipation des défis juridiques futurs
La science-fiction est depuis longtemps pour l’humanité le miroir des fantasmes des innovations technologiques. En effet, cela reflète aussi bien nos espoirs que nos craintes envers les nouvelles technologies. Ainsi, à mesure que la technologie progresse, de nouveaux défis éthiques et juridiques émergent, et les histoires de science-fiction offrent un terrain fertile pour analyser ces questions complexes et délicates. Par exemple :
L’œuvre de Neuromancien de William Gibson date de 1984, et pourtant elle explore déjà les enjeux de la cybernétique et des droits numériques, posant des interrogations sur la vie privée et la responsabilité dans un monde ultra-connecté.
La science-fiction est donc un moyen avant-gardiste de s’interroger sur des thèmes comme la protection de la vie privée, la responsabilité des plateformes, la cybercriminalité, l’éthique de l’IA. En effet, la science-fiction peut permettre au droit d’anticiper les problèmes que peuvent engendrer les innovations technologiques.
Par ailleurs, un autre sujet important abordé dans la science-fiction est la bioéthique, au travers d’œuvres comme :
Le roman Les Enfants de la consigne de David Brin, publié en 1993, qui explore les conséquences de l’édition génétique, ainsi que du clonage, engendrant un débat sur les droits des humains issus de ces technologies. Cette œuvre littéraire amène les lecteurs à envisager la nécessité de régulations juridiques convenables pour garantir les droits de ces nouveaux êtres, reflétant ainsi les préoccupations juridiques relatives à la dignité humaine et à l’identité de l’individu.
D’autre part, la régulation de l’IA constitue aussi un sujet central dans la science-fiction. Par exemple :
Le film Ex Machina qui fut réalisé par Alex Garland et sorti en 2014. Il s’agit d’un thriller psychologique qui plonge profondément dans les méandres de l’intelligence artificielle (IA) et des questions éthiques qui en découlent. Ledit film raconte l’histoire de Caleb, un jeune programmeur, qui est invité par Nathan, son patron, à évaluer Ava, un robot humanoïde doté d’une IA avancée. Cette œuvre cinématographique soulève des interrogations sûres : qui est responsable si une intelligence artificielle donc une IA cause un dommage ?
Ainsi, les histoires de science-fiction nous incitent à anticiper et à trouver des réponses juridiques appropriées avant que la technologie ne cause des préjudices éthiques et juridiques.
Par conséquent, ces scénarios hypothétiques ne doivent pas rester que dans la sphère du divertissement. En effet, certains peuvent servir d’outils d’anticipation, afin de permettre aux juristes de naviguer dans un futur complexe où les développements technologiques modifient la structure juridique même de nos sociétés. Ainsi, en s’appuyant sur certains récits de science-fiction, les systèmes juridiques des États pourraient mieux appréhender les défis futurs et ainsi protéger plus efficacement les droits individuels et collectifs face aux innovations technologiques et les transformations qu’elles apportent au mode de vie de nos sociétés contemporaines.
Réflexion sur des problèmes sociétaux contemporains
La science-fiction est souvent perçue comme un genre littéraire permettant à l’esprit de ses lecteurs de s’évader, pourtant elle sert aussi de reflet sur les préoccupations d’ordre éthiques et juridiques. Ainsi, à travers des récits futuristes et des réalités alternatives qu’ils proposent, les œuvres de science-fiction abordent des enjeux sociétaux intéressants tels que la justice, la surveillance du plus grand nombre et la protection de la vie privée. Ces sujets sont non seulement pertinents dans le cadre de récits fictifs, mais ils apportent parfois un point de vue juridique sur les limites du droit positif face aux nouvelles technologies et l’importance qu’a le droit prospectif. Par exemple :
L’œuvre 1984 de George Orwell publiée en 1949 et l’œuvre Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley publiée en 1932, qui examinent les implications d’un État de surveillance, où les gouvernements font usage abusif des technologies afin de contrôler et de surveiller leurs citoyens. Ainsi, de tels récits mettent en avant les craintes qui concernent la vie privée et la liberté individuelle. Ces œuvres posent des questions cruciales sur les limites et les responsabilités des États dans la collecte de données.
Ainsi, grâce au prisme de la science-fiction, le public est invité à réfléchir à l’équilibre entre sécurité et liberté et utilisation de certaines innovations technologiques, un débat qui d’ailleurs est plus que d’actualité en 2024 où la société est de plus en plus connectée et les innovations technologies jouent un rôle non négligeable dans nos sociétés à travers le globe.
En outre, des œuvres contemporaines comme Black Mirror ou alors Love, Death & Robots explorent les répercussions des innovations technologiques sur les normes sociales, juridiques, éthiques et les interactions humaines. Ces œuvres démontrent comment l’innovation peut parfois augmenter les injustices, touchant ainsi directement au domaine des droits fondamentaux des individus. De telles œuvres peuvent permettre de s’interroger sur les réformes juridiques nécessaires pour une société plus équitable et surtout plus respectueuse des droits des individus.
Par conséquent, en incorporant des messages critiques dans leurs récits, les auteurs et autrices de science-fiction offrent la possibilité d’élargir le débat public sur les questions juridiques et sociales. En effet, grâce à leur capacité à anticiper les enjeux futurs au travers de leurs histoires, cela peut permettre aux juristes et aux acteurs des nouvelles technologies de développer des législations adaptées aux défis éthiques et juridiques de ce début de 21ième siècle.
La synergie entre science-fiction et droit
La science-fiction, en tant que genre narratif débordant d’imagination, peut jouer un rôle non négligeable dans l’évolution du droit. En effet, comme le montre la résolution du Parlement européen du 16 février 2017 qui aborde les trois lois de la robotique, la science-fiction peut nourrir le débat public et stimuler l’imagination législative des États, car certaines œuvres permettent d’apporter des perspectives nouvelles pour anticiper et répondre aux enjeux sociétaux complexes découlant des nouvelles technologies.
En effet, en intégrant des concepts novateurs et des récits hypothétiques, la science-fiction incite à réfléchir sur des solutions juridiques adaptées aux innovations technologiques et aux mutations sociétales que cela engendre.
Par conséquent, il est important de souligner que cette osmose entre science-fiction et droit ne doit pas se limiter à des considérations passives ; elle doit aussi permettre de favoriser l’émergence de recherches futures. Ainsi, de nouvelles études pourraient analyser comment cette forme d’art inspire des projets de lois ou bien des révisions juridiques. En effet, en étudiant des œuvres de science-fiction avec une approche critique, les chercheurs pourraient peut-être mieux cerner les dynamiques évolutives du droit face aux nouvelles technologies et ainsi arriver à anticiper les besoins juridiques pour obtenir des régulations juridiques adaptées à notre société en pleine métamorphose.
Copyright © 2024 legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter