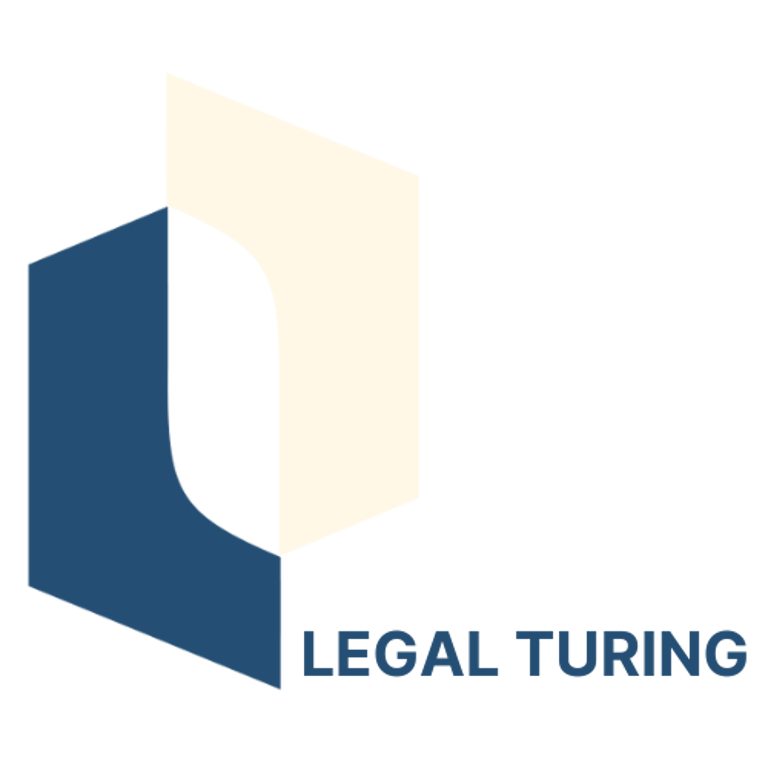Episode "Playtest" de la saison 3 de Black Mirror : les dangers de la réalité augmentée
L'épisode "Phase d'essai" (Playtest) de la saison 3 de Black Mirror plonge les spectateurs dans l'univers du jeu vidéo immersif utilisant la réalité augmentée.
DROIT ET SCIENCE-FICTION
C.Becouze
4/16/20255 min read


Synopsis de l'épisode "Phase d'essai" (Playtest)
Le protagoniste, Cooper, est un jeune homme à la recherche d'une solution pour financer la fin de son tour du monde. C'est dans ce contexte qu'il accepte de tester un jeu de réalité augmentée développé par une entreprise technologique. Ce jeu utilise une technologie avancée, promettant de mélanger le réel et le virtuel de façon déconcertante. En effet, l'intelligence artificielle (IA) du jeu exploite les peurs de l'utilisateur pour garantir une expérience unique[1]. Ainsi, au fil de l'expérience, le protagoniste subit une série de défis qui vont non seulement transformer ses peurs, mais aussi ses souvenirs en une réalité dystopique.
De ce fait, l'épisode "Phase d'essai" (Playtest) soulève des questions juridiques sur l'usage des nouvelles technologies dans le domaine du divertissement et des expériences cognitives. En outre, l'IA utilise les peurs et les souvenirs de l'utilisateur, ce qui interroge sur le respect de la vie privée et sur l'obtention d'un consentement éclairé[2]. En effet, l'utilisateur partage ses données personnelles lors de la partie, ouvrant la porte à de potentiels abus par l'entreprise qui lui fait tester le jeu.
Par ailleurs, le scénario de cet épisode de Black Mirror pose des questions éthiques concernant la santé mentale des utilisateurs de jeux utilisant la réalité augmentée. En effet, une telle utilisation des innovations technologiques sur la psyché humaine peut augmenter la dépendance à ces expériences virtuelles et potentiellement mettre les utilisateurs en danger[3].
L'importance de recueillir le consentement et de ne pas négliger l'information pré-contractuelle
En l'espèce, l'entreprise de jeux vidéo fait signer au protagoniste un contrat de test sans qu'il ait pleinement conscience des risques encourus.
D'un point de vue juridique, cela pose la question du consentement libre et éclairé, qui est un principe fondamental du droit des contrats et du droit des consommateurs en droit français[4]. En effet, lorsqu'un utilisateur accepte de participer à des expériences technologiques, il est important qu'il soit suffisamment informé des risques éventuels. Néanmoins, le concept de consentement éclairé est difficile à garantir face à des technologies capables de manipuler les perceptions. Si l'utilisateur ne comprend pas pleinement les implications de son engagement, l'expérience devrait être annulée.
La collecte des données personnelles pour rendre l'expérience encore plus immersive et unique
En l'espèce, l'expérience immersive de réalité augmentée nécessite la collecte d'une quantité importante de données personnelles, notamment celles concernant le comportement et les émotions de l'utilisateur.
Ainsi, cet épisode de Black Mirror met en lumière la protection d'un nouveau genre de données. En France et en Europe, de telles collectes doivent respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD)[5]. En effet, l'entreprise doit garantir que les données récupérées pendant l'expérience sont traitées de manière sécurisée et transparente.
Néanmoins, l'épisode met en avant des failles dans la façon dont ces données peuvent être exploitées, voire divulguées, ce qui représente un risque pour la vie privée de l'utilisateur.
La protection des droits d'auteur pour les créations d'une IA générant des jeux de réalité augmentée
En l'espèce, grâce à la collecte de données très personnelles, l'IA peut créer une histoire basée sur les peurs et les souvenirs de son utilisateur.
Les créations originales, telles que les environnements virtuels et les expériences narratives, peuvent donc nécessiter une protection par le droit d'auteur. En droit français, celui-ci repose sur la reconnaissance de la créativité et de l'originalité d'une œuvre, généralement attribuée à une personne physique[6]. Ainsi, pour être protégée, une œuvre doit résulter d'un effort intellectuel humain. Or, les créations issues d'une IA, bien qu'inspirées par des données humaines, sont le fruit d'algorithmes sans intervention humaine directe.
Par conséquent, l'utilisateur pourrait être reconnu comme auteur, selon les cas, ou l'œuvre pourrait rester sans auteur au sens juridique.
Éthique en matière d'expérimentation de jeux de réalité augmentée
En l'espèce, l'IA utilise une technologie lui permettant d'exploiter les peurs conscientes et inconscientes de l'utilisateur.
L'épisode met en évidence le danger d'une telle technologie immersive. En effet, cela soulève des questions éthiques autour des expériences de manipulation cognitive et de conditionnement psychologique[7]. Une technologie aussi puissante pourrait engendrer des conséquences irréversibles sur la perception de la réalité et provoquer des risques de troubles mentaux.
Il faudrait donc que l'entreprise s'assure que des protocoles d'évaluation psychologique soient mis en place pour anticiper les réactions néfastes.
Droits des testeurs en matière d'expérimentation de programmes de réalité augmentée
En l'espèce, une expérimentation sur le psychisme humain est réalisée avec comme cobaye un sujet humain.
Les expériences sur les êtres humains sont soumises à des principes éthiques et juridiques stricts, comme la Déclaration d'Helsinki[8], qui vise à encadrer les essais cliniques afin que les bénéfices pour le participant surclassent les risques encourus. Dans l'épisode, ce principe est transgressé : l'utilisateur-testeur est exposé à des effets psychologiques graves sans encadrement médical.
Par conséquent, le scénario montre le déséquilibre de pouvoir entre l'entreprise et l'utilisateur, où ce dernier est exploité comme un simple cobaye.
Déterminer qui est responsable en cas de mauvais fonctionnement d'un jeu de réalité augmentée
En l'espèce, le protagoniste rallume son téléphone pendant l'expérience, provoquant une surcharge neurale. La question de la responsabilité se pose : qui est fautif ?
L'article 121-3 du Code pénal et l'article 1245-10 du Code civil apportent des pistes. Le premier définit les responsabilités en cas de faute indirecte ou d'omission. Le second stipule que le producteur n'est pas responsable si le défaut est imputable à la conception ou à des instructions erronées[9].
L'entreprise peut aussi éviter la responsabilité si le défaut était indécelable au moment de la mise en circulation du produit.
Protéger les utilisateurs de jeux de réalité augmentée
Ainsi, l'épisode "Phase d'essai" met en lumière des thèmes comme l'isolement et la vulnérabilité face à des technologies immersives. Le droit positif pourrait être inadapté pour protéger la propriété intellectuelle dans le cas des IA. Il faudrait repenser les cadres juridiques pour définir plus clairement la titularité des droits sur les créations générées par des intelligences artificielles et dans les espaces virtuels.
En somme, cet épisode de Black Mirror n'est pas qu'une fiction, mais une réflexion sur les enjeux éthiques, juridiques et humains des technologies immersives.
Notes de bas de page :
L'intelligence artificielle (IA) désigne des systèmes capables de simuler des fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, la perception ou la prise de décision.
Le consentement éclairé implique une information compréhensible, suffisante et librement acceptée par le participant.
Voir par exemple les recherches sur la cyberdépendance et les troubles dissociatifs induits par les expériences immersives prolongées.
Code civil français, art. 1109 et suivants (relatifs au consentement dans le contrat).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cf. recherches en neuroéthique sur les effets des technologies immersives sur la cognition et l'identité personnelle.
Déclaration d'Helsinki adoptée par l'Association médicale mondiale (1964), révisée en 2013.
Article 1245-10 du Code civil : exception de responsabilité du producteur.
Copyright © 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter