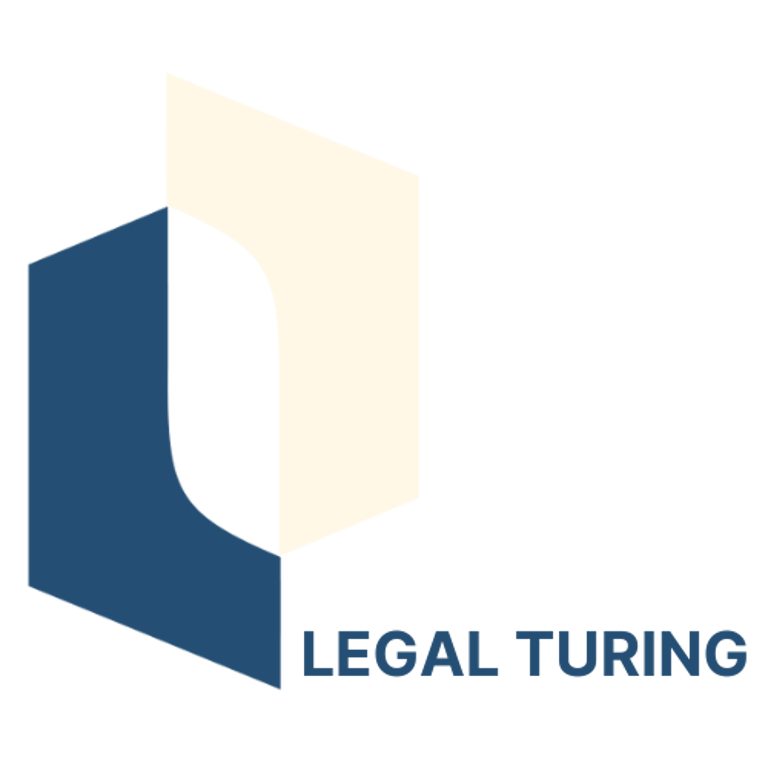Black Mirror : dernière partie de l’épisode « Blanc comme neige » et parallèles juridiques
Épisode Black Mirror : parallèles juridiques explore les implications en lien avec la vie privée, les droits de l'enfant, la réponse pénale.
DROIT ET SCIENCE-FICTION
C.Becouze
7/31/20245 min read

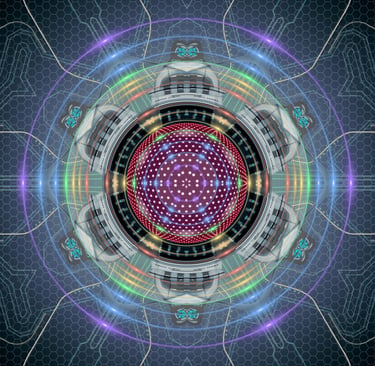
Cet article va analyser juridiquement la dernière partie de l’épisode « Blanc comme neige » de Black Mirror, qui est composée de trois parties, formant chacune un épisode distinct. En effet, cette dernière partie soulève plusieurs questions éthiques et juridiques qui peuvent être mises en parallèle avec le droit français et européen, notamment en matière de protection des données personnelles, de droit de la famille et de droits fondamentaux.
1. Le droit à la vie privée et la protection des données
L’épisode met en lumière des préoccupations concernant la protection des données personnelles et le droit à la vie privée. En France et en Europe, ces questions sont régies principalement par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
RGPD : Ledit règlement protège les données personnelles des individus au sein de l’Union européenne. Ainsi, les mesures décrites dans l’épisode, telles que le « blocage » de l’accès aux informations personnelles et la manipulation des données, sont contraires aux principes du RGPD. En effet, ce règlement garantit que les individus ont un contrôle sur leurs données personnelles et protège contre les traitements injustifiés ou abusifs.
Droit français : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) supervise le respect de ces règles. De ce fait, toute forme de manipulation ou de restriction de l’accès aux données personnelles, comme celle décrite dans l’épisode, serait illégale et constituerait une violation des droits de la personne.
2. Les droits de l’enfant et la responsabilité parentale
L’épisode explore la question de la paternité et du droit de l’enfant à connaître ses parents, ainsi que les obligations des parents.
Droit français : Le Code civil stipule que tout enfant a le droit de connaître ses parents. De plus, les parents ont des responsabilités envers leurs enfants, y compris leur fournir un soutien affectif et matériel. Ainsi, la situation où Joe est exclu de la vie de sa fille, même si cela est autorisé par une décision de justice, soulève des questions éthiques sur la transparence et les droits parentaux.
Droit européen : La Convention européenne des droits de l’enfant protège les droits des enfants et stipule que les États doivent garantir que les enfants puissent maintenir des relations personnelles avec leurs deux parents, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.
3. Les peines et le système judiciaire
L’épisode aborde aussi les conséquences de la culpabilité et la manière dont les personnes sont punies.
Droit français : Le système pénal garantit des droits fondamentaux aux accusés, y compris le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. De ce fait, la notion de punition virtuelle, comme celle où le personnage est condamné à une souffrance perpétuelle, n’existe pas dans le droit pénal français, qui privilégie des peines réelles et proportionnées.
Droit européen : La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) assure que toute personne a droit à un procès équitable et que les peines ne doivent pas être inhumaines ou dégradantes. Par conséquent, la torture ou les peines cruelles sont interdites, ce qui inclut les punitions psychologiques prolongées et les traitements qui dégradent la dignité humaine.
4. Le droit à la réhabilitation et la réintégration sociale
L’épisode soulève des questions sur la réhabilitation et les droits après une condamnation.
Droit français : Ce dernier inclut des mécanismes de réhabilitation pour les personnes condamnées. Les condamnations ne devraient pas empêcher indéfiniment une personne de mener une vie normale. Ainsi, le système judiciaire vise à permettre la réinsertion sociale des condamnés.
Droit européen : La CEDH protège les droits des condamnés à la réhabilitation et à la réinsertion sociale. En effet, l’idée que quelqu’un soit condamné à une stigmatisation permanente sans possibilité de réhabilitation serait incompatible avec les standards européens en matière de droits humains.
5. Risques en cas de décès ou d’assassinat
Cette troisième partie de l’épisode « Blanc comme neige » de Black Mirror soulève également des questions cruciales sur les conséquences du blocage lorsqu’une personne est décédée ou lorsqu’un individu est victime d’un assassinat. Par conséquent, ces scénarios mettent en évidence les risques potentiels et les complications juridiques associés à l’utilisation de telles technologies.
a. Décès d’une personne bloquée
En cas de décès d’une personne soumise à un blocage, plusieurs questions se posent :
La notification et la gestion des données : En cas de mort d’une personne bloquée, la gestion de ses données personnelles devient complexe. En effet, le droit français prévoit que les données des personnes décédées sont régulées différemment, et des mesures spécifiques doivent être prises pour leur gestion. En outre, la CNIL exige que les données des défunts soient respectées et que les proches puissent en demander la suppression ou l’archivage.
Accès aux informations et héritage : Les héritiers ou les proches du de cujus (personne décédée) doivent souvent accéder aux informations pour régler des questions administratives ou successorales. Ainsi, un tel blocage pourrait compliquer ces tâches et engendrer des difficultés supplémentaires, en particulier si les informations sont cruciales pour la gestion, par exemple, de la succession.
b. L’assassinat d’une personne bloquée
Si une personne bloquée est victime d’un assassinat, plusieurs enjeux juridiques et éthiques se présentent :
Enquête et accès aux preuves : Le blocage pourrait entraver les enquêtes criminelles en limitant l’accès aux informations essentielles. Par ailleurs, les enquêteurs pourraient rencontrer des obstacles pour collecter des preuves ou obtenir des témoignages si le blocage interfère avec les communications ou l’accès aux données pertinentes.
Responsabilité et justice : La technologie de blocage pourrait également compliquer la détermination de la responsabilité en cas d’assassinat. En effet, si des éléments cruciaux pour comprendre le mobile ou les circonstances du crime sont bloqués, cela pourrait affecter la capacité des autorités judiciaires à poursuivre les responsables de manière adéquate. De ce fait, une telle technologie ne serait pas conforme au RIA (Règlement sur l’IA), dit aussi AI Act, car elle représenterait un risque inacceptable.
Le respect des droits humains
Cette partie de l’épisode « Blanc comme neige » décrit un scénario où la technologie est utilisée pour infliger des punitions de manière extrême, ce qui va à l’encontre des principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme en droit français et européen. En effet, les systèmes juridiques en Europe se concentrent sur la protection des données personnelles, les droits des enfants, le traitement équitable des accusés et les mécanismes de réhabilitation, et ils sont conçus pour éviter justement les abus de pouvoir comme ceux dépeints dans l’épisode. En outre, les scénarios de décès ou d’assassinat d’une personne bloquée mettent en évidence les lacunes et les défis associés à l’utilisation de technologies de blocage. Par conséquent, ces situations soulignent l’importance du RIA, qui permet une régulation équilibrée et réfléchie de telles technologies pour protéger les droits et les intérêts de toutes les parties concernées.
Copyright © 2024 Legalturing. Tous droits réservés.
Inspiration
Rendre le droit accessible à tout le monde.
Copyright © 2024 - 2025 legalturing. Tous droits réservés.
Nos réseaux sociaux
Nos vidéos
FAQ & nous contacter